La chromatographie sur couche mince (CCM ou TLC en anglais pour thin layer chromatography) est une technique courante permettant d’observer de manière qualitative la composition d’un mélange. Il s’agit d’une méthode rapide, universelle, peu chère et économe en produits chimiques permettant de vérifier la pureté d’un composé ou l’avancement d’une transformation chimique.
Principe général d’une CCM (dite en phase normale)
Une plaque CCM est constituée d’un support (verre, aluminium ou plastique) sur lequel sont déposés, de manière industrielle, une très fine couche de silice SiO2 (s) et un révélateur UV-visible. Il s’agit donc d’un environnement très polaire puisqu’à la surface de la plaque (au contact de l’air) se trouvent des fonctions silanols R3Si-OH.
Le mélange à analyser est déposé en très petite quantité sur une plaque CCM : des interactions faibles (van der Waals, liaison hydrogène, etc.) vont alors s’établir entre les composés chimiques et la silice. Un solvant adéquat (beaucoup moins polaire que la silice) va ensuite éluer sur cette plaque par capillarité. De nouvelles interactions faibles (van der Waals, liaison hydrogène, etc.) vont alors s’établir entre le produit déposé et le solvant entrant en compétition avec les interactions faibles précédemment établies.
Ainsi, les composés polaires préfèreront interagir avec la silice (polaire) et ne seront donc quasiment pas élués par le solvant.
Tandis que les composés moins polaires voire apolaires préfèreront établir des interactions avec le solvant et vont donc migrer avec lui lors de la capillarité du solvant sur la plaque.
Une révélation sous une lampe UV permettra de repérer les produits sous forme d’une tache violette sombre : les composés polaires se trouvant en bas de plaque, les composés moins polaires en haut de plaque.
Remarque : si les composés ne sont pas visibles par révélation à la lampe UV, il est possible de les révéler chimiquement en utilisant des réactifs de révélation (permanganate de potassium, ninhydrine, diiode, etc.).
Comment réaliser en pratique une belle plaque CCM ?
- préparer une cuve fermée avec le solvant (ou le mélange de solvants) adapté (quelques millimètres de solvant au fond de la cuve suffisent !)
- récupérer une plaque CCM neuve sans la toucher avec les doigts sur la partie blanche (risque de contamination)
- tracer au crayon gris une ligne de base (sans rayer ni percer la plaque : si c’est le cas, il faut recommencer !). La ligne de base doit être au-dessus du niveau de solvant de la cuve sinon la plaque sera illisible.
- déposer avec un capillaire une goutte du produit à étudier sur la ligne de base (le produit doit être dilué sinon la plaque sera illisible)
- si vous disposez de plusieurs produits (réactifs, produits commerciaux de référence) : les déposer sur la plaque et créer un co-spot (point où sera déposé l’ensemble des produits)
- déposer délicatement la plaque dans la cuve puis la refermer (vérifier que la ligne de base n’est pas immergée)
- ne pas déplacer ou toucher la cuve
- enlever la plaque lorsque le solvant a presque atteint le haut de plaque et faire un trait au crayon sur la ligne de front (niveau maximum atteint par le solvant)
- laisser sécher la plaque quelques instants
- révéler la plaque sous lampe UV en entourant les taches au crayon
Remarque : une plaque peut être conservée dans un cahier si elle est totalement sèche et scotchée sur toute sa surface.
Il est fréquent de calculer un rapport frontal dans les comptes-rendus de TP : il s’agit du rapport entre la distance ligne de base – tache du produit et la distance ligne de base – ligne de front. Cette grandeur est constante pour un mélange de solvants donné et une température donnée.
Vidéo explicative : Réaliser une CCM
En cours de création !
Pour aller plus loin : Comment faire la différence entre un produit formé en cours de réaction et un sous-produit de dégradation de la réaction ?
L’apparition d’une nouvelle tache sur une plaque CCM n’est pas toujours la preuve que la transformation se déroule correctement (formation de produits). Il peut aussi s’agir de sous-produit(s) de dégradation due à l’instabilité d’un des réactifs, de la trop haute température réactionnelle ou encore de phénomènes d’oxydation (présence d’air et/ou d’eau).
Afin de vérifier ce point, une plaque CCM doit tout d’abord être éluée, séchée puis révélée comme précédemment. Ensuite, la plaque est retournée de 90° puis à nouveau éluée avec le même solvant, séchée puis révélée.
Si toutes les taches se retrouvent alignées le long de la diagonale de la plaque : il s’agit de produit(s) de réaction.
Si des taches apparaissent hors de la diagonale de la plaque : il s’agit de sous-produit(s) de réaction.
Vidéo explicative : Faire la différence entre produit(s) et sous-produit(s)
En cours de création !
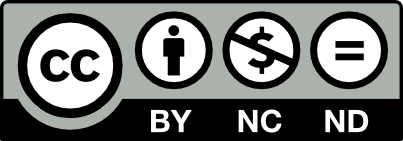
Cet article est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – Pas de Modification 4.0 International.